Crédit photo: © mangeonsbien.com
Courrier international – L’humanité tire 75 % de son alimentation de douze plantes et de cinq espèces animales. Il est essentiel de diversifier ces ressources. Du riz de mer à l’arbre à pain, tour du monde des semences du passé qui pourraient nourrir la planète de demain.
Par Tom PAGE / CNN (extraits), Atlanta
C’est dans les entrailles de poissons qu’Ángel León a entrevu l’avenir des produits de la mer. Petit, le futur chef étoilé avait pour mission de vider les poissons que sa mère cuisinait, ce qui lui a permis d’examiner ce qu’ils mangeaient. “C’est à partir de là que j’ai commencé à jouer avec la cuisine”, se souvient-il. Ángel León, figure emblématique d’Aponiente, un restaurant trois étoiles près de Cadix, dans le sud de l’Espagne, s’inspire de l’océan pour créer des plats dont l’ingéniosité envoûte sa clientèle. Chez lui, tout ou presque est permis : un plat traditionnellement cuisiné avec du veau met la peau de poisson à l’honneur, sur un menu qui propose aussi du plancton.
Selon Ángel León, l’océan est un “grand garde-manger”. Il rêve de découvrir de nouveaux ingrédients dans ses profondeurs. Il fait actuellement des expériences avec le riz de mer, une graine extraite de la zostère, plante herbacée des mers de l’hémisphère Nord. La texture de cette céréale est à mi-chemin entre le riz et le quinoa, et elle n’a pas le goût de l’eau de mer, précise le chef, avant d’ajouter qu’on pourrait en tirer de la farine pour faire du pain, des pâtes et des gâteaux.
Déterminé à cultiver ce riz de mer, Ángel León s’est associé au biologiste des milieux marins Carlos Duarte. “Les prairies sous-marines peuvent être une source d’aliments sains pour les humains, sans que cette culture nécessite d’eau douce, de terres cultivables, d’engrais, d’herbicides ou de pesticides, le tout en piégeant du CO2, détaille Carlos Duarte. Cela paraît presque trop beau pour être vrai, mais c’est pourtant vrai.”
Ne vous y trompez pas, il est indispensable d’explorer d’autres options alimentaires. Aujourd’hui, l’humanité tire 75 % de son alimentation de douze plantes et de cinq espèces animales, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Plus de 90 % des variétés cultivées ont disparu ces cent dernières années, parallèlement à la standardisation de l’agriculture.
En mettant pour ainsi dire tous nos œufs dans le même panier, nous accentuons la malnutrition et le diabète dans le monde, et nous risquons de saper la viabilité à long terme des récoltes. L’uniformisation des variétés exploitées et leur production intensive menacent la santé des sols et leur biodiversité et ouvrent la voie aux nuisibles ainsi qu’aux bactéries pathogènes.
Autrement dit, nous devons diversifier notre alimentation et notre agriculture, sans quoi davantage d’êtres humains pourraient être confrontés, à terme, à des pénuries alimentaires. Les scientifiques et les populations du monde entier cherchent à rendre notre alimentation plus durable et trouvent de nombreuses solutions en se tournant vers le passé. De l’Afrique de l’Ouest à l’Amérique du Sud, des plantes et des variétés autrefois courantes, mais tombées en désuétude, révèlent leur potentiel.
Le riz de mer, des prairies marines à la table étoilée de Cadix
C’est le cas du riz de mer, une denrée prometteuse et plus ancienne qu’il n’y paraît. On sait que les Seri (ou Comcáac), ethnie de la région mexicaine de Sonora, mangeaient cette céréale, comme en attestent des preuves remontant au XVIIe siècle, explique Juan Martín Bermúdez, directeur de la recherche et du développement et conseiller environnemental pour le restaurant Aponiente. Juan Martín Bermúdez s’est rendu à Sonora, où il a observé les grandes prairies sous-marines qui s’étendent le long du littoral. Des habitants lui ont préparé du riz de mer, mais c’était la première fois en quarante ans qu’ils en cuisinaient.
Sur place, une initiative coordonnée par des écologistes forme des jeunes afin de préserver les traditions, mais ils ont besoin de soutiens, explique-t-il. “Nous avons le devoir de nous inspirer des populations autochtones et du profond respect qu’elles ont pour les écosystèmes, martèle Bermúdez. Nous sommes sur le point de perdre ces savoirs.”
Juan Martín Bermúdez les a rapportés en Espagne. Aponiente prévoit de régénérer une partie des zones humides du littoral de Cadix en plantant des zostères importées de Santander, dans le nord de l’Espagne, et de les semer dans les marais salants, dont la plupart sont aujourd’hui abandonnés.
Même si l’expérience est encore balbutiante, Aponiente s’est déjà associé à l’ONG Oceans 2050, dont fait partie Carlos Duarte, afin de recréer des prairies sous-marines dans d’autres régions du monde, comme aux États-Unis, au Mexique et en Europe.
Et Bermúdez précise que les gastronomes ne seront pas les seuls bénéficiaires du projet. “Si nous plantons des zostères dans ces estuaires, nous attirerons de nombreux invertébrés, de nombreux poissons. La culture du sel, la culture locale, qui est menacée de disparition, trouvera un nouvel élan grâce à cette innovation.”
Ángel León y tient plus que tout, bien plus qu’à l’approbation de ses pairs. “Découvrir de nouveaux aliments dans la mer m’enthousiasme bien plus que n’importe quelle étoile Michelin, insiste-t-il. Nous laisserons ainsi un héritage bien plus marquant, c’est-à-dire de nouvelles façons de nous nourrir.”
Les pommes de terre andines,une police d’assurance pour le monde
Le jour de son mariage, Esperanza Gabriel a reçu des pommes de terre en cadeau, tout comme son mari, Elmer Chavez. Et à Huancavelica, dans les Andes péruviennes, le couple cultive côte à côte ces dons depuis vingt ans. Ils tirent de la terre des pépites indigo, rose vif, brunes ou blanches ; elles ont toutes des bosses et des protubérances. Ce sont des pommes de terre, mais elles ne ressemblent pas à celles que nous connaissons.
Esperanza et Elmer, qui appartiennent tous deux au peuple Quechua, sont les gardiens de ces tubercules. Ils cultivent environ 300 types de pommes de terre sur les 4 000 variétés comestibles connues, dont une majorité est endémique des Andes. Ils consomment leur production et en vendent une partie, mais leur activité est aussi une police d’assurance, pour eux et peut-être un jour pour le monde.
“Le lieu où ils cultivent les pommes de terre est une zone à risques”, explique Stef de Haan, chercheur au Centre international de la pomme de terre, à Lima. Les maladies et les aléas météorologiques peuvent frapper, c’est pourquoi multiplier les variétés est “une stratégie pour les atténuer”.
C’est une leçon de bonne pratique agricole. Plus de 1 milliard d’humains consomment des pommes de terre, qui sont la troisième culture vivrière dans le monde après le riz et le blé. Pourtant, on ne vend qu’un très petit panel de variétés dans les supermarchés. Et la monoculture accentue le risque qu’une maladie anéantisse l’intégralité d’une récolte, comme cela a été le cas en Irlande pour la variété Lumper, dévastée par le mildiou [à partir de 1845]. Une catastrophe à l’origine de la Grande Famine irlandaise (par la suite, des scientifiques ont découvert qu’une pomme de terre sud-américaine comportait un gène résistant à ce mildiou).
“En matière de sécurité alimentaire et de protection environnementale, la diversité agricole est la clé de l’adaptation et de notre avenir, souligne Stef de Haan. Si nous ne préservons pas dans une banque génétique l’ensemble de ces pommes de terre, nous n’aurons pour ainsi dire aucune option à l’avenir. [Ces exploitations amérindiennes] sont un laboratoire qui n’est pas géré par des scientifiques. C’est un laboratoire qui est depuis plus de dix mille ans aux mains des paysans.”
Le fonio, la graine idéale pour un monde aride
En Afrique de l’Ouest, c’est une céréale surnommée la “graine du paresseux” qui est pressentie pour devenir un aliment de base dans l’une des régions les plus arides du globe.
Le Sahel s’étend sur dix pays au sud du Sahara, où les projections scientifiques annoncent une hausse des températures 1,5 fois supérieure à la moyenne mondiale. Les ravages du dérèglement climatique (sécheresses et crues) frappent déjà les 300 millions d’habitants de cette région, dont plus de 10 % souffriraient d’insécurité alimentaire selon les Nations unies.
Il est urgent de trouver des solutions, notamment dans un pays comme le Sénégal. “Nous devons trouver des plantes adaptées à la sécheresse”, affirme Mame Codou Guèye, chercheuse au Centre d’étude régional pour l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse (Ceraas), à Thiès, à l’est de Dakar. Cultivé en Afrique de l’Ouest depuis environ sept mille ans, le fonio est “la plante idéale”, souligne-t-elle.
Cette céréale qui pousse vite n’est pas fragile et peut être cultivée dans des sols rocailleux, sableux ou acides, et elle nécessite peu d’eau et aucun engrais. Mais le fonio n’est pas sans poser de problèmes.
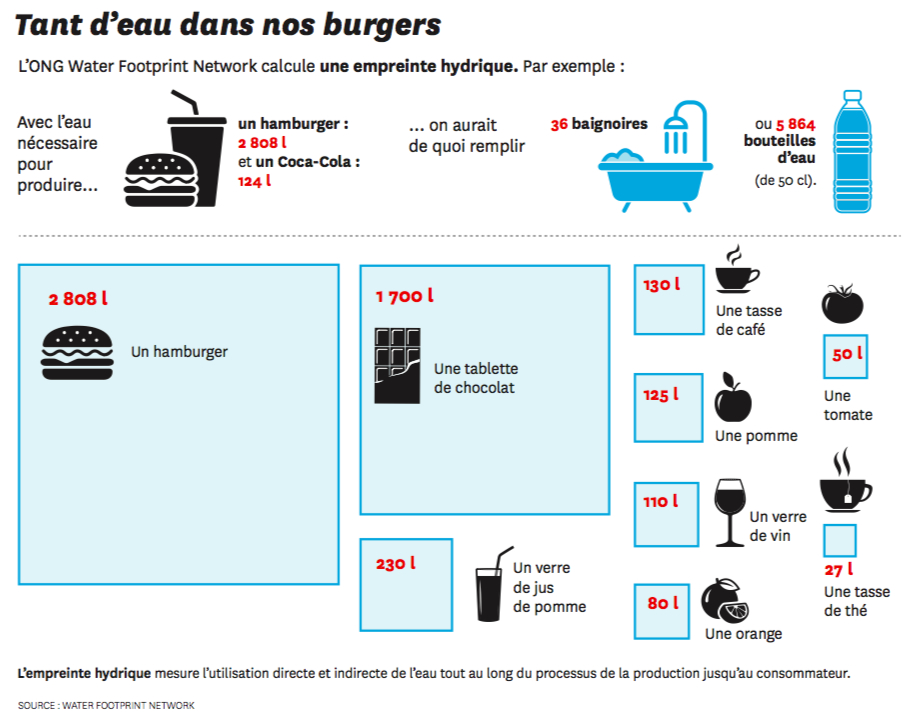
Sanoussi Diakité, ingénieur agronome sénégalais, explique que la production a baissé, car la transformation du fonio est complexe. Un pilage laborieux est indispensable afin de séparer les graines de leur enveloppe, un inconvénient qui l’a poussé à inventer une machine dans les années 1990 : elle permet de décortiquer 5 kilos de fonio en moins de dix minutes, ce qui prendrait des heures en le faisant à la main.
Ce procédé n’est pas encore généralisé, mais le sujet se révèle de plus en plus pertinent, à mesure que les vertus du fonio arrivent aux oreilles du grand public, notamment parce que cette graminée est sans gluten.
Certains sont convaincus que le fonio pourrait devenir une culture d’exportation, et c’est notamment le cas de Pierre Thiam, chef cuisinier sénégalais installé aux États-Unis, qui accommode le fonio dans son restaurant new-yorkais et le vend sous la marque Yolélé dans les supermarchés Whole Foods et sur Amazon.
Nourrir le Sahel est néanmoins la question la plus pressante et cultiver du fonio pourrait avoir d’autres avantages pour les populations locales. Son immense système racinaire freine l’érosion des sols, ce qui est particulièrement pertinent dans une région qui subit une désertification progressive. Sanoussi Diakité évoque par ailleurs le “tapis herbacé” restant une fois le fonio cultivé qui régénère les sols.
“En développant la culture du fonio, nous encourageons la préservation de la biodiversité, ajoute l’agronome. Tous ces éléments font du fonio une céréale essentielle pour l’environnement.”
L’arbre à pain ou l’“arbre de vie”
À Hawaii, certaines familles plantent encore un ’ulu à la naissance d’un enfant pour perpétuer une tradition ancestrale liée à un arbre mythique : cette essence endémique de Nouvelle-Guinée a été importée dans l’archipel du Paciique par des Polynésiens qui se servaient de son bois léger pour construire leurs pirogues, qui tissaient son écorce pour en faire des textiles, qui utilisaient ses feuilles à des fins thérapeutiques et sa sève pour imperméabiliser des surfaces, et qui mangeaient son grand fruit nourrissant. Cet “arbre de vie” portait décidément bien son nom.
’Ulu a ensuite hérité du nom de “fruit à pain”, donné par les Européens, qui trouvaient que l’odeur du fruit cuit au feu évoquait celle du pain. Aujourd’hui encore, il conserve une place de choix dans la cuisine traditionnelle, mais l’exploitation de l’arbre a reculé au profit d’autres cultures tropicales.
Diane Ragone travaille pour l’institut Breadfruit sur l’île hawaïenne de Kauai, un organisme qui dépend du Jardin botanique tropical des États-Unis. Elle veut rendre au fruit à pain ses lettres de noblesse. “L’arbre à pain a de nombreux bienfaits environnementaux”, explique-t-elle. Sa canopée freine la pluie, protégeant ainsi les sols de l’érosion, et il nourrit plusieurs espèces animales, dont des oiseaux rares.
Il sert aussi aux humains, explique Noel Dickson, agronome au Jardin botanique. L’arbre à pain est, certes, difficile à faire pousser sous certains climats, mais il se plaît beaucoup sous les tropiques et nécessite peu d’attention par rapport à d’autres plantes. “Il est difficile, surtout à Hawaii, d’être agriculteur et de gagner assez d’argent pour payer les factures, souligne Noel Dickson. Souvent, c’est parce qu’il faut acheter des outils ou d’autres choses, comme de l’engrais. Un agriculteur peut réduire les coûts, diversifier son activité et exploiter l’ensemble de ses terrains en faisant de l’arbre à pain le socle de son agroforêt.”
Le fruit à pain peut être consommé à diverses étapes de sa maturité : encore vert, le fruit a le goût du cœur d’artichaut ; mûr, il est nourrissant et rappelle le manioc ou la pomme de terre. Sous cette forme, il peut être cuit ou séché pour être transformé en farine. Les leurs mâles peuvent être confites, ce qui en fait des bonbons.
Faire connaître le fruit à pain en dehors du Pacifique et des Antilles pourrait encourager davantage de personnes à le cultiver et diffuser l’idée que les aliments traditionnels ont le potentiel de protéger la planète et de nourrir ses habitants.
“Il est crucial que l’humanité dispose de cultures durables compatibles avec les spécificités de l’environnement local”, insiste Diane Ragone.
T.P.
Publié le 1er novembre


