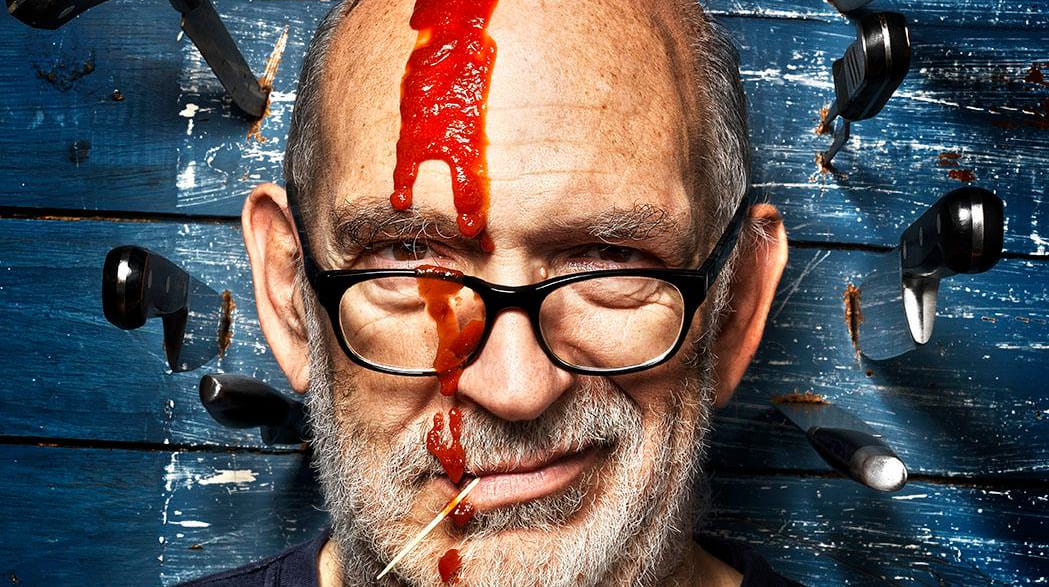Photo: © Copyright ignaciomedina.net
Pour le redoutable critique gastronomique espagnol Ignacio Medina, qui vit au Pérou, la crise sanitaire et économique a fait éclater la bulle dans laquelle vivait le monde de la restauration. Dans cet entretien, il appelle les chefs à descendre de leur piédestal pour faire revenir les clients dans un lieu crucial.
Entretien conduit par Emilio Camacho / La República (extraits), Lima
LA REPÚBLICA : Vous aimez fréquenter les marchés ?
IGNACIO MEDINA : Bien sûr. Jusqu’au début du confinement, je m’y rendais deux fois par semaine. Au marché, je me promène, j’achète, je décide de ce que je peux faire. Aller au marché m’a surtout appris à cuisiner autrement, à faire des plats plutôt que des recettes. Autrement dit, je ne vais pas au marché avec une liste de courses. Si je veux préparer un ajiaco [soupe de pommes de terre], je ne demande pas 200 grammes de patates ou du potiron. J’achète ce qui a l’air bon, ce dont j’ai envie. Et, tout en achetant, je réfléchis. Si j’ai pris des haricots blancs, je vais peut-être pouvoir ajouter des gambas. Ce n’est pas une recette normale, elle ne sort d’aucun livre, mais elle permet de retourner aux sources de la cuisine, de revenir à ce qu’elle a toujours été, une affaire de survie.
Pour vous, le marché est une aventure sensorielle : on palpe, on sent les produits, on regarde s’ils sont bons.
C’est quelque chose de sensoriel et de mental. La première chose que je fais quand j’arrive dans une ville que je ne connais pas, c’est d’aller au marché, car c’est là qu’on trouve tout. Au marché, on voit comment est cette ville, comment est cette société, on voit qui achète, on voit si c’est la maîtresse de maison ou la bonne. On peut observer le soin qui entoure les produits, la propreté, on peut en déduire le degré de développement social – cela renvoie aux origines, aux racines, aux liens. En fait, je préfère aller au marché que cuisiner, c’est tout à fait passionnant.
Et comment quelqu’un comme vous, qui adore les marchés, vit-il la situation actuelle, où ces lieux sont l’un des principaux foyers de contamination ?
Eh bien, figurez-vous que j’allais au marché Mendiburu de San Isidro, tout près de La Mar, où j’habite, et après deux semaines, pour des raisons évidentes, j’ai décidé de ne plus y aller. Pour moi, le plus grand danger était d’utiliser des pièces et des billets. L’argent liquide passe entre beaucoup de mains tout au long de la journée.
Je comprends votre décision. Mais il y a des gens qui sont obligés d’aller au marché, et là les règles de distanciation physique ne sont pas respectées. Comment ça se fait ?
La distanciation physique sur les marchés est quelque chose de forcé, d’imposé. Il y a un monsieur qui vous invite à faire la queue, avec des marques au sol qui vous disent où vous placer. Il y a une demoiselle qui vérifie votre température. Alors on a l’impression qu’il se passe quelque chose. Quand on n’a personne à la porte [du marché couvert] pour vous dire ce qu’il faut faire, on se relâche. Mais il faut garder la tête froide. C’est grave, ce qui se passe. Je fais partie des personnes à risques. J’ai 64 ans, 10 kilos de trop, je suis diabétique. J’ai perdu des proches dans cette pandémie.
Les marchés, c’est aussi les plats populaires, les petits étals.
Oui, c’est sûr, ce n’est pas possible qu’on ferme le marché aux fruits et que le lendemain toutes les rues alentour se remplissent de marchands ambulants. Nous devons changer, bien comprendre que tout cela est très compliqué, que cela va nous affecter en tant que société sur des plans que nous n’imaginons même pas. J’écris pour un quotidien, je suis travailleur indépendant et j’en subis les conséquences, je n’ai pas de prévisions de revenus pour un an. Et puis je pense à la dame qui venait faire le ménage chez moi une fois par semaine, ou au monsieur du marché, maintenant que celui-ci est fermé. Ou au serveur du restaurant, quand son patron va lui dire qu’il n’a plus besoin de lui.
Parlons-en. En mars, vous avez écrit dans El País un article à propos des conséquences de la pandémie sur la restauration. Vous disiez : “La crise du coronavirus ouvre une nouvelle séquence dans un secteur habitué à vivre un jeu d’apparences éternel.” Pourquoi ?
Bon, j’y parlais de la cuisine haut de gamme. Ce secteur est entré dans une dynamique perverse, les restaurateurs croient que leur valeur dépend de leur fréquence d’apparition dans les médias. Et cela se fait au détriment de l’activité elle-même. Ils ne font pas les comptes comme ils le devraient. Et lorsqu’on analyse le secteur, on s’aperçoit qu’ils vivent constamment dans le rouge, qu’ils versent la moitié des salaires le premier jour du mois et l’autre moitié le 20, quand ils ont effectué des encaissements, et qu’ils ne paient pas leurs fournisseurs. Autrement dit, ils vivent au-dessus de leurs moyens, une vie de luxe, de faste – surtout depuis l’apparition des classements, comme les “50 meilleurs restaurants d’Amérique latine” [liste établie par le groupe britannique William Reed Business Media]. Ils se disent : je vais, je viens, je voyage, j’invite ce cuisinier. Résultat, leurs employés sont au salaire minimum, ou ils ne leur paient pas la sécurité sociale. Et parfois, ils dépensent leur argent dans la vidéo du congrès auquel ils ont assisté.
Vous parlez des grands personnages du boom gastronomique ?
Oui, les grands cuisiniers qu’il y a au Pérou, au Chili, en Colombie. Ce n’est pas seulement un phénomène péruvien, cela concerne toute l’Amérique latine. Bien sûr, avec un tel système, on peut dire qu’on a ouvert une filiale à Bogotá, une autre à Santiago et une autre à Madrid. Mais il y a toujours des investisseurs, parce que nous avons créé un modèle qui n’est pas réel. Et ce modèle qui n’est pas réel, fondamentalement, c’est celui de Gastón Acurio [superstar de la cuisine péruvienne, à l’origine de plusieurs émissions de télévision]. Acurio est quelqu’un qui dit : “J’ai 48 restaurants et ils ont du succès, je suis une référence pour tous les autres restaurateurs.” Et il y a des investisseurs qui s’y intéressent, qui s’imaginent que c’est l’affaire du siècle. Et quand ils entrent au restaurant et qu’ils se rendent compte qu’un restaurant de haut niveau, bien géré et toujours plein, peut rapporter un bénéfice de 10 % [sur le chiffre d’affaires] au maximum, alors ils se disent que ce n’est pas possible, ils réduisent le personnel et achètent des produits moins chers. Dans ce secteur, nous avons vécu sur un mensonge, et il va falloir tomber les masques. Maintenant que les restaurants de luxe à Lima ne vont plus avoir de touristes, qui représentaient 97 % de leur chiffre d’affaires, ils vont devoir travailler pour la population locale. Et comment vont-ils le faire ? Vont-ils maintenir des prix à 200 dollars sur un marché qui se contracte ?
Et que deviennent les écoles de cuisine ? Vous avez dit un jour qu’elles ne produisaient qu’une main-d’œuvre bon marché ?
Il y a une contradiction dans les écoles de cuisine, parce que cela coûte plus cher d’y étudier que ce qu’on va gagner quand on travaille.
Mais comment est-ce possible ?
Ces écoles coûtent 60 ou 70 % de plus par mois que le salaire qu’on va percevoir si on trouve du travail. Nous sommes sur un marché où un cuisinier d’un restaurant de luxe, sans responsabilités, ne gagne que 1 200 soles [environ300 euros] par mois. Ensuite, il y a cette idée que 10 % de tout le chiffre d’affaires doit être redistribué entre tous les salariés. Dans certains restaurants, cela peut être des sommes importantes, mais dans 99 % des établissements, le cuisinier n’en voit pas la couleur.
Et tout cela, avec la pandémie, c’est une bulle qui a éclaté.
C’est ce que me disait Virgilio Martínez (le patron du restaurant Central [à Lima]) dans une interview qu’il m’a donnée il y a quatre ans. L’autre jour, je réécoutais l’enregistrement. Il disait : “Je le dis comme je le pense, c’est une bulle pleine de fumée et, le jour où elle va éclater, ça va aller mal pour nous.” Une chose est sûre : l’évolution de la cuisine est liée à celle de la société. Les restaurants commencent quand les classes moyennes apparaissent. Jusqu’au moment où en France on a créé les restaurants, les cuisiniers étaient dans les cuisines de la grande bourgeoisie. En Espagne, le développement de la cuisine commence dans les années 1980, avec la consolidation de sa classe moyenne. Ici, au Pérou, nous créons la première classe moyenne, parce qu’Alan García [président du pays de 1985 à 1990 puis de 2006 à 2011] l’a fait disparaître dans les années 1980. Au cours de ce processus, les touristes ont transformé la cuisine en mirage, nous avons dû créer des propositions de milieu de gamme.
Parlons des nouvelles habitudes de cette quarantaine. Qu’est-ce que vous avez contre les tutoriels de tortillas de patatas [omelettes espagnoles aux pommes de terre] qu’on a vus fleurir pendant le confinement ?
Non, je n’ai rien contre. (Il sourit.) Instagram est devenu la grande vitrine de la pandémie, et tout le monde fait des likes en montrant comment il cuisine, et pendant les premières semaines tout le monde nous apprenait à faire sa tortilla de patatas. Et je me souviens d’un cuisinier péruvien, dans un tutoriel, qui faisait n’importe quoi. Il faisait frire les pommes de terre et ensuite il les mettait au réfrigérateur. Quand une pomme de terre se refroidit et qu’ensuite on la réchauffe, chez moi [en Espagne] on dit que c’est de la semelle, elle devient caoutchouteuse. On peut laisser refroidir les pommes de terre, mais pas les mettre au frigidaire.
Alors, c’était ça, le secret…
Bon, et puis il y a aussi le fait qu’en Espagne il y a une grande querelle qui divise le pays en deux camps : ceux qui font la tortilla uniquement avec des patates et ceux qui la font avec des patates et des oignons. Et ils se détestent.
Comment ça ?
Mais si, ils se détestent profondément. (Il rit.) Et soudain, bim, tout le monde se met à faire de la tortilla con patatas sur Instagram et le débat fait rage. C’est lié à la pandémie. Je suis sûr que pour vous c’est pareil, quand vous allez sur Instagram, vous trouvez au moins une personne en train de cuisiner et de parler, avec 15 personnes connectées.
Le monde des apparences…
La cuisine a toujours été un monde de faux-semblants. Vous avez des gens qui vont au restaurant pour conclure une affaire, pour signer un divorce. Des gens qui y vont pour impressionner une demoiselle, des gens qui y vont pour s’y montrer, pour voir si on les voit, pour dire qu’ils y ont été, et aussi certains qui vont pour y manger, ceux des trois tables au fond à droite. Ces gens-là regardent du côté gauche de la carte, là où sont inscrits les noms des plats. Les autres regardent à droite, du côté des prix.
La livraison de plats cuisinés [par l’intermédiaire de plateformes en ligne] démontre que les fiers habitants de Lima, la ville qui voulait être la capitale gastronomique d’Amérique du Sud, ne savent pas faire la cuisine ?
Non, en fait, la conséquence la plus positive de la pandémie est que les gens ont recommencé à cuisiner. Nous avons mis quelques mois à voir arriver la livraison à domicile. Jusqu’à présent, ce qu’il y avait dans ce domaine, c’était des entreprises qui livraient par exemple des paniers de légumes, des poissons. La livraison, c’est une libération. Quand les restaurants rouvriront leurs portes, il y aura une ou deux semaines pendant lesquelles cela deviendra Noël [fin juin, le Pérou a autorisé la réouverture partielle des restaurants, sur certaines parties du territoire]. En Espagne, c’est ce qui s’est produit avec le vin. Un distributeur me disait qu’il n’en avait jamais vendu autant, même à Noël, y compris les bouteilles les plus chères.
Vous vous êtes fait livrer pendant la quarantaine ?
Deux fois. Un de ces cageots avec des légumes du potager. Et j’ai arrêté de commander, parce que la moitié des choses qu’on m’apportait ne servaient à rien. C’étaient des herbes aromatiques, elles étaient très bien, mais je ne m’en servais pas. Et puis il faut que je pense à faire durer mon argent jusqu’à la fin de l’année. En ce moment, je dois faire attention à ce que j’achète. La dernière fois, je suis allé chez Wong [chaîne de supermarchés] et je me suis dit : “Je vais me faire un petit plaisir.” Mais le kilo de bavette coûtait 90 dollars [80 euros]. Et pour 500 grammes, on me demandait 150 soles [38 euros]. L’autre jour, on m’a demandé 220 soles [56 euros] pour un kilo de patelles cuites. Alors qu’elles sont vendues à 8 soles [2 euros] le kilo sur le port.
La livraison de plats cuisinés, n’est-ce pas la négation de notre culture gastronomique? Quand je dis cela, je pense par exemple au ceviche [plat national péruvien à base de poisson cru mariné], qu’on ne peut pas trans porter dans une caisse derrière un scooter.
Non, bien sûr, pas plus que les poissons ou calamars frits. Je ne vais quand même pas commander un poisson frit, fourré dans une caisse, et qui va arriver humide et trop cuit. Non, en réalité je dirais que la livraison peut avoir du bon, mais il faut réfléchir à ce qu’on fait. Et on ne peut pas faire livrer une carte de 60 plats. Non, la livraison, ce n’est pas fait pour ça. Et comment on peut réduire les coûts ? En concentrant l’offre. Plus la carte sera longue, plus on va avoir besoin d’employés, plus il y aura de pertes sur la marchandise.
Nous avons des encyclopédies de recettes anciennes, des plats qui ont gagné des concours, des variétés de tubercules et de fruits, et pourtant nous revenons toujours au bon vieux goût du pollo a la brasa [poulet braisé] avec des frites. Comment l’expliquer ?
Je pense que nous avons là un problème endémique, et je m’y inclus : nous sommes ravis de nous connaître. Et comme nous aimons nos petites habitudes, nous ne sommes pas capables de faire l’effort [d’aller vers la découverte]. La cuisine péruvienne est presque infinie, et pourtant dans une ville comme Lima, qui compte environ 12 millions d’habitants [en incluant Callao], si l’on retire les chifas [restaurants chinois] et les nikkei [restaurants de cuisine fusion nippo-péruvienne], et qu’on passe les cartes en revue, on ne trouvera pas plus de 40 plats différents.
Et, au sommet de cette pyramide, le pollo a la brasa.
Bien sûr, le pollo a la brasa, qui est un symptôme de ce que je vous disais, le fait que nous sommes très popotes. Le Péruvien est convaincu que le pollo a la brasa est une invention péruvienne, comme le panetón. Eh bien, non ! Le pollo a la brasa se prépare depuis qu’il y a du poulet et du feu. Et le panetón [panettone] est confectionné en Italie depuis le xviie siècle.
Qu’est-ce qui devrait se passer alors pour que vous fassiez la queue chez un volailler ?
Détrompez-vous, je suis allé à plein d’endroits que personne n’imaginerait. Il y a des jours où on sort pour bien manger, et d’autres où on sort seulement pour manger. Quand je vivais en Espagne, je me promenais à la Puerta del Sol [grande place madrilène] et je me disais : bon, je vais m’en mettre plein la panse. Et je suis allé dans des restaurants de hamburgers, de toutes les enseignes. Nous le faisons tous. Comme quand on appelle un resto chinois à emporter et qu’il vous apporte ces boîtes toutes grasses. (Il rit.) On le fait tous. Écoutez, on mange plus avec sa mémoire qu’avec son palais. Et nous autres, les Espagnols, quand nous allons dans un bar, en Espagne, nous revivons une bonne partie de notre enfance.
Que deviennent les producteurs pendant la pandémie ? On ne parle pas d’eux en ce moment ?
Le producteur est le maillon le plus faible de la chaîne, c’est lui va le plus souffrir de tout cela. Je n’ai aucun doute en ce qui concerne la salubrité de ce qui se produit au Pérou, ni quant aux conditions dans lesquelles c’est produit. En revanche, je peux avoir des doutes sur la chaîne de distribution, de transport, ou sur le système de vente du marché. Le fait est que nous avons transformé les producteurs en mirage. Tout le monde en parle, tous les grands chefs se font photographier avec eux, ils tournent des vidéos, pour ensuite les montrer pendant les congrès. Mais ensuite, qui achète à ces producteurs, en quelles quantités et à quel prix ?
Les producteurs sont un alibi.
Ce qui se passe, c’est qu’on veut avoir un lien très étroit avec le producteur, mais la plupart d’entre nous ont du mal à comprendre qu’ils ont parfaitement le droit de vivre dans la dignité. Or nous ne voulons pas leur payer le juste prix. Ce que nous voulons, c’est les trois B : bon, beau, bon marché. Il y a un fossé qui va se creuser, avec d’un côté une grande offre de produits, et de l’autre peu de restaurants pour les acheter.
E.C.
Entretien publié le 24 mai